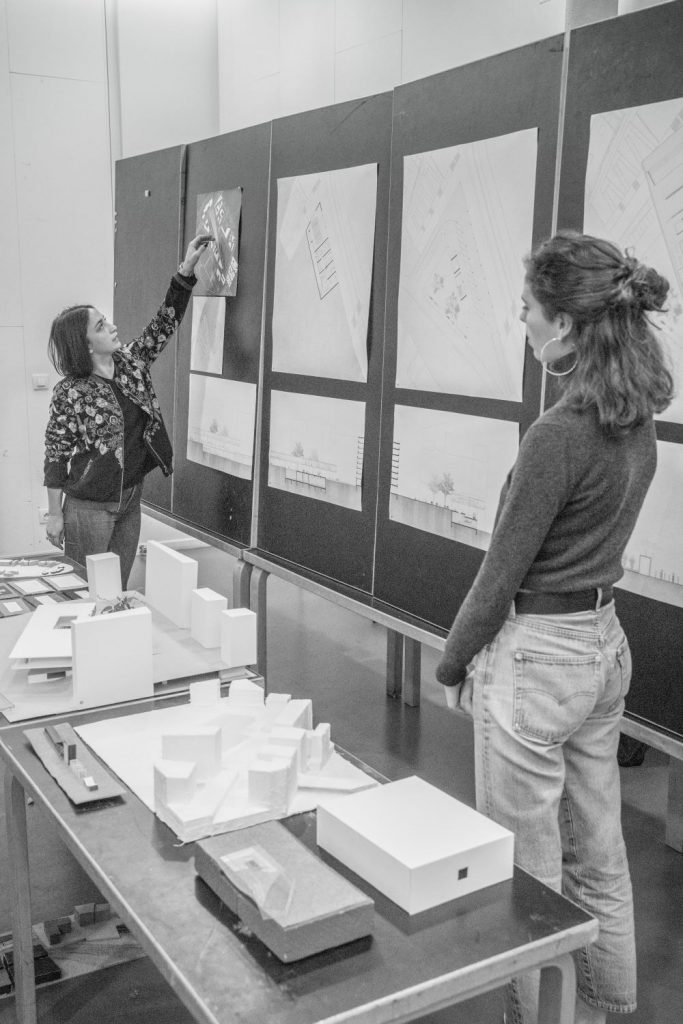
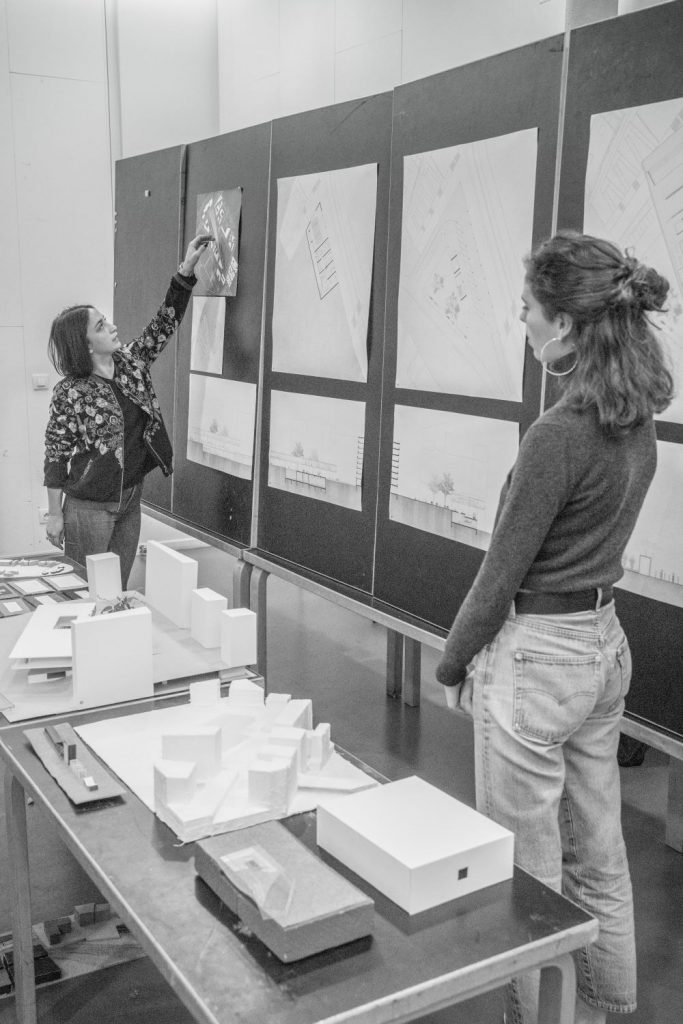

L’objet de la formation est d’acquérir la capacité de formuler des propositions architecturales et urbaines de réponses aux risques en lien avec les populations et les territoires concernés.
Une catastrophe se produit au croisement d’une vulnérabilité et d’un aléa et le risque est la mesure de la probabilité de cette catastrophe. Si les aléas sont par nature difficiles à maîtriser, les architectes peuvent travailler à la réduction des vulnérabilités en se rappelant par exemple que ce ne sont pas les séismes qui tuent, mais les bâtiments qui s’écroulent sur ceux qui les habitent.
Les étudiants du DSA acquièrent des connaissances solides en prévention et gestion des vulnérabilités face aux questions de séisme, d’inondations, de climats violents ainsi que dans la gestion des crises humanitaires et sociales qui peuvent en découler. Ils améliorent leurs connaissances architecturales et constructives pour mieux faire face aux aléas naturels et/ou humains.
Consulter les modalités de candidature
objectifs
- apprendre à prévenir et gérer les risques d’origine naturelles et anthropiques, dans le respect du cadre de vie,
- appréhender la gestion du risque comme une action globale qui s’inscrit dans un environnement complexe : architectural, urbain et naturel, social et économique, et surtout humain,
- améliorer ses compétences techniques dans l’ensemble des domaines liés à la construction, en particulier en situation de crise.
points forts et spécificités
- seule formation en France dédiée spécifiquement à la question des risques en lien avec l’architecture,
- suivi personnalisé par des enseignants spécialistes, dédiés semestre par semestre et sur l’ensemble de la formation,
- formation à la prévention et gestion des risques majeurs et des situations de crise à partir de la démarche et avec les outils de l’architecte,
- liens avec de nombreux intervenants extérieurs, spécialistes des différents risques et de leur gestion : Association Française du Génie Parasismique (AFPS), Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (C-PRIM), Craterre, Croix Rouge Internationale, Médecins Sans Frontières, Architecture et Développement…,
- voyage d’études à chaque semestre destiné à travailler en situation (en France métropolitaine /outre-mer ou étranger),
- une session, dirigée par un spécialiste de la Croix Rouge Internationale, dédiée à la gestion des situations de crise humanitaire,
- une session, réalisée en partenariat avec Craterre, consacrée à la construction terre,
- construction d’un prototype architectural à l’échelle 1 conçu par les étudiants, lié à la problématique du 3ème semestre (construction, généralement en bois et terre, permettant d’acquérir une meilleure maîtrise des techniques constructives à disposition des architectes),
- l’obtention du diplôme avec la mention recherche permettant de se diriger vers un doctorat.
thématiques
- 1er semestre : introduction des enjeux de la gestion des risques ; approche architecturale de la gestion des risques sismiques,
- 2e semestre : climat, eau et territoire (adaptation et développement),
- 3e semestre : vents, urgence, précarité, reconstruction et développement,
- 4ème semestre : mise en situation professionnelle, rédaction puis soutenance du mémoire de fin d’étude.
déroulement de la formation
La formation se déroule sur 4 semestres : 3 semestres d’enseignement suivis d’un quatrième semestre de mise en situation professionnelle et d’élaboration d’un mémoire.
- Les 3 premiers semestres dédiés aux enseignements sont composés de cours, d’ateliers de projets et de voyages d’étude ainsi que d’un workshop de construction au troisième semestre. La périodicité est de 7 à 8 sessions par semestre, ce qui correspond à une semaine d’enseignements (du lundi au samedi) toutes les 2 semaines. Les voyages d’études peuvent s’étendre sur une période de quinze jours consécutifs. A cela s’ajoute, le temps de travail personnel des étudiants entre chaque session. Les étudiants ont des travaux à réaliser seul ou en groupe.
- Le 4ème semestre est consacré à la mise en situation professionnelle (MSP) et à la rédaction d’un mémoire de fin d’étude dédié à une problématique définie avec son enseignant référent. Ce mémoire de compose d’une partie de 15 à 30 pages dédiée à la MSP et d’une seconde partie de la même longueur dédiée à la problématique.
- Le diplôme est obtenu à la suite d’une soutenance de présentation de la MSP et du mémoire.
Si l’étudiant souhaite voir son diplôme assorti de la mention « recherche », permettant un meilleur accès vers la poursuite des études en doctorat, le mémoire doit être sensiblement plus conséquent (au moins une centaine de page consacrées à la problématique) et un jury spécifique doit être réuni.
compétences à acquérir
- assimiler les connaissances architecturales techniques pour prévenir et gérer les différents situations de risques : séismes, inondations, vents violents, situations de crises humanitaires et sociales,
- dresser un diagnostic in situ et élaborer des projets, à l’échelle architecturale – qu’il s’agisse de concevoir des bâtiments nouveaux ou d’intervenir sur le patrimoine existant -, et à l’échelle urbaine voire territoriale,
- agir dans les situations d’urgence et de crise en prenant en compte les problématiques de développement durable et de la ville résiliente, que la catastrophe vienne de se produire ou qu’elle soit latente (cas du bidonville),
- capacité à développer un regard réflexif, critique et constructif sur la gestions des risques.
durée, poids horaire et crédits
- durée de la formation : 24 mois avec un volume horaire encadré de 1 200h (et un volume équivalent de travail personnel),
- crédits : 120 ECTS (European Credit Transfer System),
- formation diplômante : le DSA est un diplôme national d’enseignement supérieur de 3e cycle.
- La formation se déroule sur 2 années universitaires selon les textes réglementaires en vigueur (3ème inscription sur dérogation uniquement).
équipe pédagogique
Responsable scientifique :
– Cyrille Hanappe, architecte, ingénieur, docteur en architecture, maître de conférences à l’Énsa de Paris-Belleville
Responsable pédagogique :
– Élodie Pierre, architecte DPLG, urbaniste (IATU – uBx Montaigne), titulaire d’un mastère spécialisé de prévention et gestion des risques, maitresse de conférences à l’Énsa de Paris-Belleville
Équipe enseignante (2024-2025) :
- Cyrille Hanappe, responsable scientifique, architecte, ingénieur, docteur en architecture, maître de conférences à l’Énsa de Paris-Belleville ;
- Élodie Pierre, responsable pédagogique, architecte DPLG, urbaniste (IATU – uBx Montaigne), titulaire d’un mastère spécialisé de prévention et gestion des risques, maîtresse de conférences à l’Énsa de Paris-Belleville ;
- Sarra Kasri, architecte DPLG (Tunisie), ingénieur (Projet Tempus – ENIT), docteur en architecture (LATTS-Université Paris Est) et titulaire d’un master en études comparatives d’aide au développement (EHESS), Professeur à l’université UMONS – Belgique et Experte ONU – UNDRR ;
- Dominique Lerche, architecte DESL, DSA ARM, co-gérant de la société TAG architecte ;
- Ludovik Bost, architecte DPLG, titulaire d’un DESS matériau bois et mise en œuvre dans la construction, (École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois à Épinal), maître de conférences à l’Énsa de Paris-Belleville ;
- Frédéric Bindji, ingénieur spécialiste du développement ;
- Xavier Génot, Architecte référent Croix Rouge Internationale ;
- Majid Hadjmirbaba, architecte et ingénieur – CRATERRE ;
- Ludovic Jonard, architecte, président de l’association Architecture et Développement ;
- Jérémy Poucin, architecte HMONP (Énsa-Pb), formation Ingénieur en bâtiment, salarié à l’agence C&E ingénierie ;
- Fang-Yu Hu, ingénieure et urbaniste, docteure en architecture de l’université Paris-Est, chercheure associée de l’IPRAUS ;
- Nombreux intervenants ponctuels
insertion professionnelle
- administrations publiques travaillant sur la question des risques,
- agences d’architecture spécialisées en ce domaine qui proposent leurs services aux mêmes administrations,
- collectivités locales qui ont des responsabilités et des compétences en termes de prévention des risques majeurs, et de gestion de ces risques,
- organisations non gouvernementales (ONGs),
- institutions internationales œuvrant dans le domaine de la gestion de crise au niveau mondial,
- laboratoire de recherche dédiés aux problématiques du DSA.