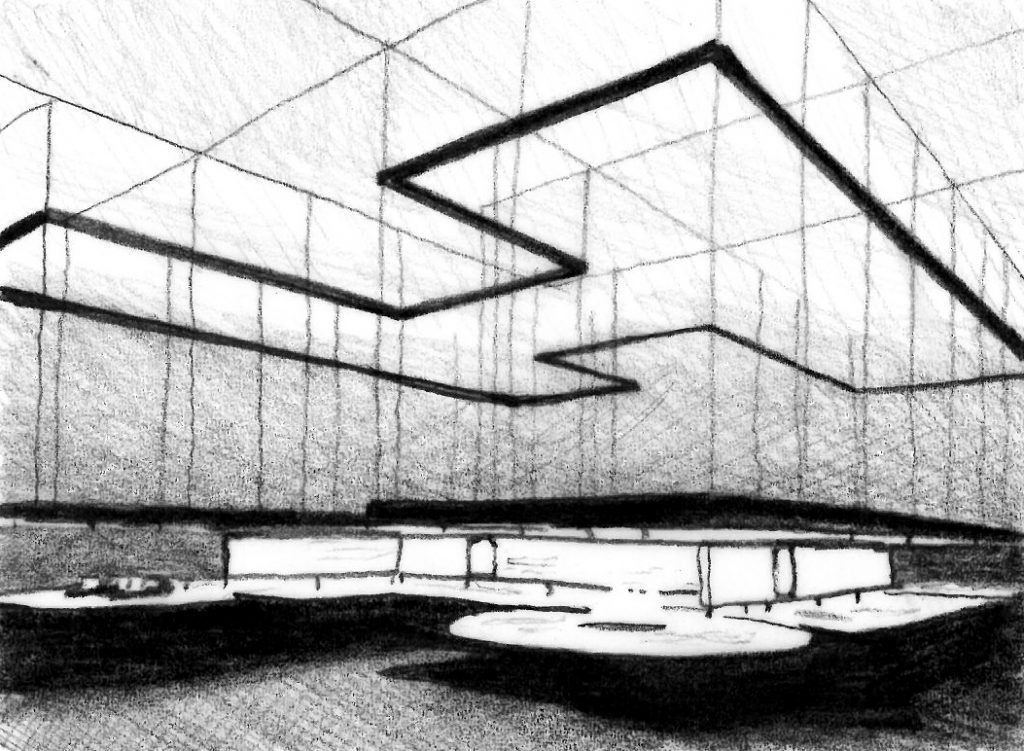
mastère spécialisé® architecture et scénographies
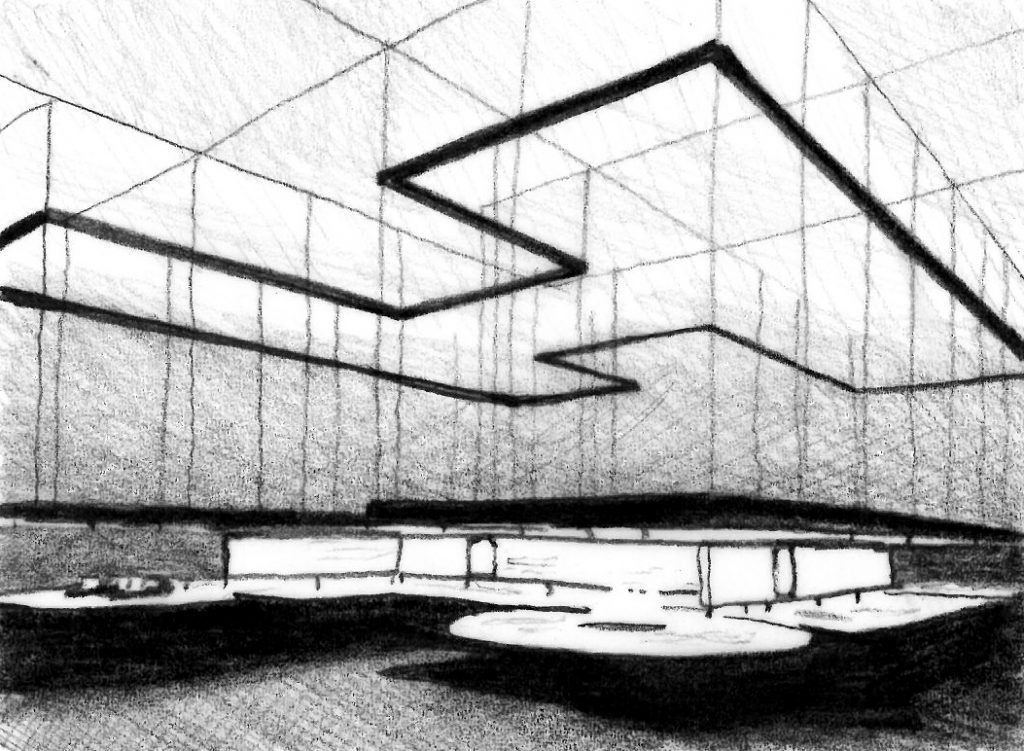
La scénographie, comme manière de concevoir un espace au service d’un récit, d’une performance ou d’une fiction, tient une place importante dans notre monde contemporain.
Issue du spectacle vivant, cette pratique éphémère de l’espace a investi des champs très variés de notre expérience quotidienne, allant du théâtre au musée, en passant par l’espace public ou les lieux de commerces et de loisirs.
Cette omniprésence d’une forme de mise en scène pose aujourd’hui des questions à la fois politiques et pratiques.
D’un autre côté, l’architecture éphémère que constituent ces scénographies s’avère aussi parfois le meilleur moyen de répondre avec précision au contexte changeant de notre monde : faire avec des ressources et un temps limités, penser avec les acteurs locaux, révéler des imaginaires collectifs, etc..
Si le monde actuel a besoin de scénographies, il nous semble important d’apprendre à en mesurer les enjeux et à en maitriser les modalités concrètes.
Adossé à une école d’architecture (l’ENSA-PB) et à une école d’arts appliqués (l’École Camondo) – manière de l’affirmer au croisement de savoirs complémentaires –, le Mastère architecture et scénographies entend appréhender ces multiples dimensions.
objectifs
- Proposer une formation originale et polyvalente ouverte sur les domaines variés relevant de la scénographie (architecture éphémère, lieux d’exposition, évènementiel, spectacles vivants…).
- Former des “chefs de projet en architecture éphémère” : scénographie de spectacles, d’expositions, d’espaces publics, de salons et d’évènements.
- Préparer ses étudiant(e)s à penser l’architecture éphémère dans son contexte, vis-à-vis d’un public, d’une œuvre, d’une narration.
Consulter les modalités de candidature
partenaires professionnels
PARTENAIRES
La formation est soutenue par des partenaires professionnels avec lesquels elle entretient de multiples liens (interventions pédagogiques, visites, aide potentielle à la mise en situation professionnelle…) :
- le Musée des arts décoratifs (MAD),
- le Centquatre,
- la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (MC 93),
- la Société du Grand Paris,
- la Scène Nationale de l’Essonne,
- le Centre des Monuments Nationaux,
- les Ateliers Médicis,
- le Musée Guimet,
- etc…
enseignements
ENSEIGNEMENTS
En ce qui concerne les cours magistraux et les TD, la formation est attentive à dispenser de manière équilibrée :
des enseignements d’ordre technique, pour comprendre les multiples acteurs des projets scénographiques :
- maîtrise des ambiances : éclairage, matériaux du second œuvre, interfaces numériques, design sonore,…
- maîtrise des techniques de mise en œuvre spécifiques : stratégies de montage, démontage, réemploi,…
- maîtrise de la réglementation : sécurité des biens et des personnes, gestion de la foule…
- maîtrise des problématiques d’exposition et de conservation : conservation préventive, muséologie, signalétique, soclage,…
- maîtrise des problématiques liées à l’organisation d’évènements dans l’espace public : gestion budgétaire, planification, jeux d’acteurs, …
des enseignements d’ordre théorique et historique, pour aider à prendre part aux enjeux contemporains de la scénographie :
- vis-à-vis de la scène contemporaine : grands enjeux esthétiques liés à la mise en scène, spécificité des créations n’ayant pas pour point de départ de textes dramatiques, rapport scène/salle, formes performatives, théâtralité hors du théâtre…
- vis-à-vis de l’espace public : urbanisme transitoire, tiers lieux, art urbain, urbanisme culturel,..
- vis-à-vis de l’espace d’exposition : musée inclusif, réemploi, musée hors les murs, centre d’interprétation, politique de restitution, etc…
En ce qui concerne les exercices de projet, la pédagogie est attentive à ce qu’ils répondent à un certain réalisme de la commande d’une part, mais aussi à ce qu’ils ouvrent des réflexions fondamentales et prospectives d’autre part, ainsi qu’au croisement des disciplines. Les exercices de projet sont systématiquement encadrés par deux enseignant·e·s professionnel·le·s. Des intervenant·e·s ponctuel·le·s spécialistes du domaine viendront apporter des éclairages spécifiques.
Par ailleurs les intervenant.e.s seront amené.e.s à demander aux étudiant.e.s de développer leur connaissances et leur esprit critique en assistant à certains spectacles, en visitant certaines expositions etc…
déroulement de la formation
DEROULEMENT DE LA FORMATION
La formation est composée de :
1/ de janvier à juillet :
- 1 semaine inaugurale en janvier : enseignements et visites
- 3 modules (enseignements le vendredi et projet le samedi*) d’une durée de :
– 7 semaines : Scénographie d’évènementiel
– 7 semaines : Scénographie pour le spectacle
– 7 semaines : Scénographie des lieux d’exposition
- 2 workshops d’une semaine centrés sur des aspects techniques :
– Projet échelle 1
– Interactions numériques
*Il est vivement conseillé de prévoir une journée supplémentaire dans la semaine pour le travail personnel d’une semaine sur l’autre.
2/ de juillet à mars de l’année suivante :
- 1 mise en situation professionnelle de 4 à 6 mois
- suivie de la soutenance d’une thèse professionnelle (en mars).
poids horaire et crédits
La formation, d’une durée de 15 mois (de janvier à mars de l’année suivante), dispensera de manière équilibrée des enseignements d’ordre technique et d’ordre théorique et des exercices de projet pour un total de 375 heures et 75 ECTS.
équipe pédagogique 2024
EQUIPE PEDAGOGQIUE 2024*
– Savoir-faire du projet :
- Paul Marchesseau, enseignant à l’École Camondo/Architecte d’intérieur/designer
- Feda Wardak, architecte/constructeur
- Marina Khemis, designer/scénographe/muséographe, enseignante à l’école Boulle
- Vasken Yéghiayan, scénographe/architecte d’intérieur
- Laure Fernandez, enseignante-chercheuse en théâtre et arts du spectacle
- Laurent Berger, scénographe/plasticien
– Savoir-faire théoriques :
- Jean Dominique Secondi, architecte/responsable du Pôle Culture à la Société du Grand Paris
- Alphonse Sarthout, architecte
- Cloé Pitiot, architecte/Conservatrice au Centre des Monuments Nationaux
- Yann Rocher, architecte/enseignant à l’Énsa-Malaquais
- Laure Fernandez, enseignante-chercheuse en théâtre et arts du spectacle
- Béatrice Jullien, architecte/enseignante de l’Énsa-PB
- Pamela Bianchi, historienne de l’art
– Savoir-faire techniques :
- Martin Malte, designer graphique/plasticien
- Mathilde Camoin, designer scénographe/conceptrice lumière
- Omer Pesquer, consultant en projets numériques
- Arnold Pasquier, enseignant de l’Énsa-PB et de l’École Camondo/vidéaste
- Xavier Boissarie, designer
- Martin Monchicourt, responsable de l’atelier bois à l’Énsa-PB/plasticien
- Antoine Charon, enseignant de l’École Camondo/designer sonore
- Teïva Bodereau, enseignant de l’Énsa-PB/ingénieur/architecte
- Florence Bertin, conservatrice au Musée des Arts décoratifs
- Emmanuel Garnier, contrôleur technique…
* susceptible de modification
mise en situation professionnelle (MSP)
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Au cœur du dispositif de formation, l’expérience en entreprise constitue un point incontournable de la formation mastère spécialisé®.
Les étudiant·e·s doivent réaliser une mission professionnelle de 4 à 6 mois (en stage, CDD ou CDI).
Les enseignements théoriques se terminant en juillet, la MSP peut être réalisée de juillet à fin décembre à temps plein. Pour les étudiant·e·s non engagé·e·s dans la vie professionnelle, la mission en entreprise pourra débuter dès le mois de mars à temps partiel.
Chaque étudiant·e est guidé·e par un·e enseignant·e responsable du suivi pédagogique de la MSP et de la thèse professionnelle (tuteur·rice pédagogique) et un·e tuteur·rice en entreprise.
L’étudiant·e doit rédiger sa thèse professionnelle en s’appuyant sur la mission réalisée en entreprise, sous la direction du tuteur pédagogique.
Elle donne lieu à une soutenance devant jury et permet l’obtention de 30 crédits ECTS (10 crédits ECTS pour la MSP et 20 crédits ECTS pour la soutenance devant jury).